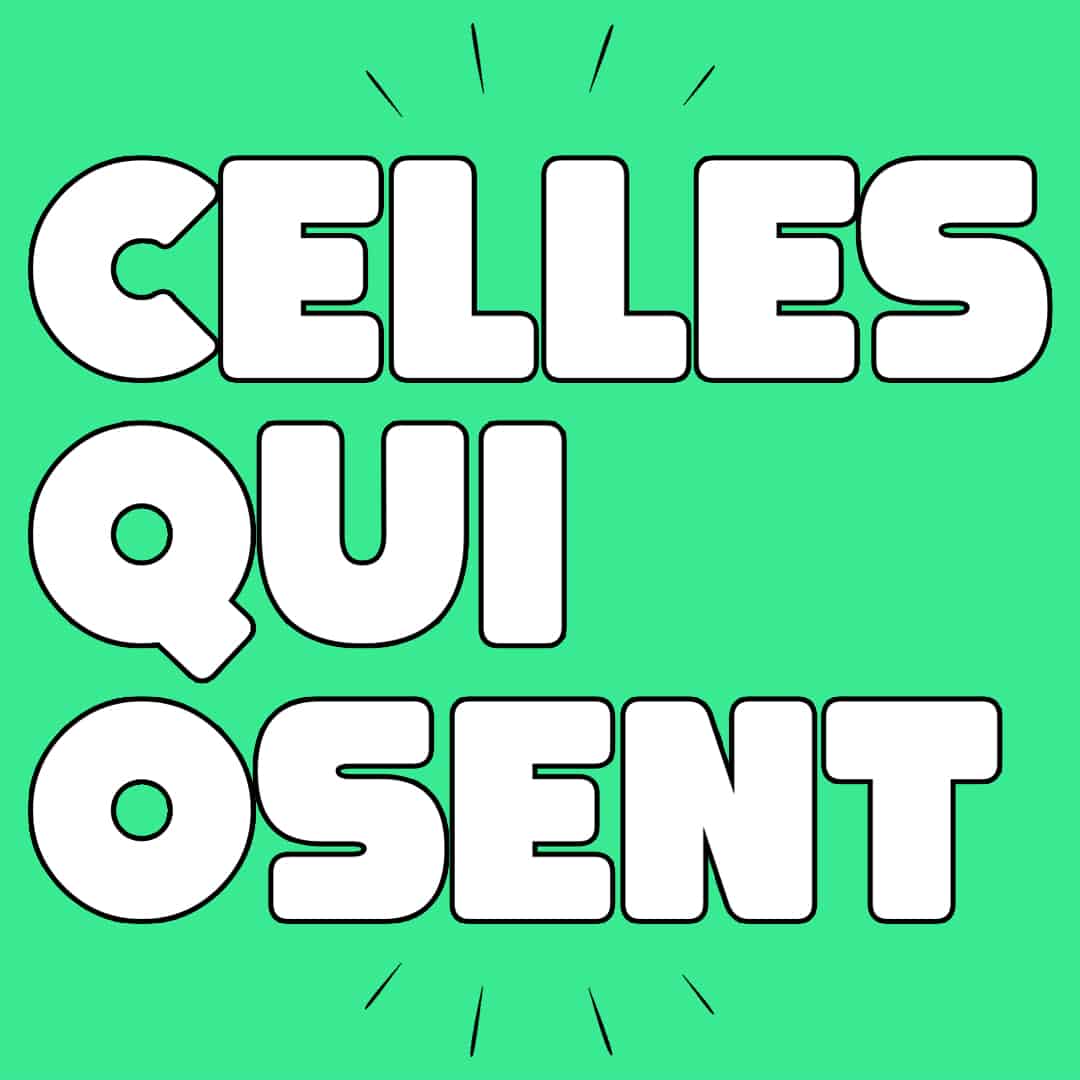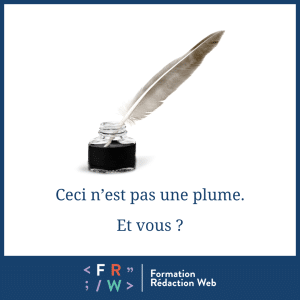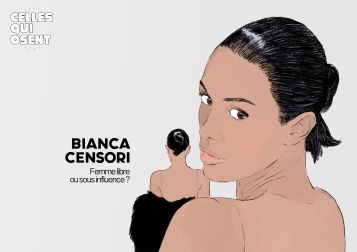Trudy Ederle : nageuse contre vents et marées
En 1926, l’américaine Gertrude Ederle, triple médaillée olympique, traverse la Manche à la nage. Elle a 20 ans et elle est la première femme à accomplir cet exploit, ce qui n’a rien d’anodin pour l’époque. Elle s’extirpe du carcan domestique assigné aux femmes au début du XXe siècle. Par passion pour un sport, elle fait bouger sans le vouloir les limites de la condition féminine… et osciller celles des préjugés. Son audace heurte les esprits et dérange. Trudy passe alternativement du stade d’insensée à celui d’icône, puis de phénomène de foire, avant de retomber dans l’oubli pendant quelques décennies.
Histoire de la reine des vagues.
Gertrude Ederle : une vie dévouée à la natation
La découverte de l’eau, un élément familier
Gertrude Ederle naît fin 1905 à New York dans une famille de commerçants d’origine allemande. C’est la troisième de sa fratrie et trois autres frères et sœurs vont suivre. A l’âge de cinq ans, elle contracte la rubéole qui lui laisse des séquelles à vie : une perte irrémédiable d’une partie de son audition. Les sons seront désormais étouffés pour la petite fille, comme dans l’eau.
Chaque été, la famille se rend sur les plages du New Jersey. Regarder les vagues de l’Atlantique lécher le sable c’est bien, mais s’y baigner c’est mieux. Le père de Gertrude décide d’apprendre à nager à tous ses enfants, filles comme garçons. Sécurité et autonomie avant le qu’en-dira-t-on, car les filles en tenue de bain, ce n’est pas très bien vu.
La naissance d’un don
Gertrude éprouve le contact de l’eau comme un univers accueillant. L’un de ses sens est diminué, mais elle compense par le développement des autres : la vue, le toucher. Elle flotte, se retourne, observe les remous et le fond sableux, ressent la caresse de l’onde. Liquide amniotique ou aire de jeu ? L’océan est à la fois son ami, le giron maternel et son espace de liberté. Elle apprend vite à se déplacer. Elle étudie comment les garçons nagent le crawl et reproduit leurs mouvements. Cela semble facile pour elle. Sa famille ne peut nier l’évidence. Bien vite, les sorties estivales à la mer ne suffisent plus à l’adolescente. Ses parents l’inscrivent avec sa sœur à l’une des deux premières organisations américaines de natation féminine : la Women’s swimming association.
Une négociation des frontières de la condition féminine
Replaçons les faits dans le contexte. Charlotte Epstein, la fondatrice de ce club, souhaite rendre accessible aux femmes les compétitions de natation jusque-là réservées aux hommes. Les Jeux olympiques sont encore récents puisqu’ils sont apparus en 1896. Ils peinent à s’ouvrir aux femmes, Pierre de Coubertin s’y oppose, au point qu’une Française, Alice Milliat, crée des olympiades féminines en 1922 à Paris. Et la natation est, contre toute attente, l’un des deux seuls sports ouverts aux femmes dès les Jeux olympiques de 1912. On compte deux épreuves de nage libre : un 100 mètres individuel et un relais 4 x 100 mètres. Petite brèche ouverte dans la pratique sportive par laquelle s’engouffrer.
Car ce sport est jugé recommandable pour les femmes, du moment qu’il ne remette pas en cause leurs facultés reproductrices. La pratique des femmes est d’ailleurs considérée comme saine et hygiéniste si elle sert d’exemple et incite leurs fils, futurs soldats, à apprendre à nager et à être capables de franchir des rivières. Mais c’est la brasse, codifiée, qui est respectable, et pas le crawl jugé alors comme agressif et nuisible à la féminité.
« Je n’approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu’elles doivent s’abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. »
Pierre de Coubertin, 1935
Libération et dépassement de soi
Quand l’adolescente âgée d’une dizaine d’années intègre la Women’s swimming association, elle est encore trop jeune pour être obligée de porter les bas réglementaires tirés au-dessus des genoux. Et la tenue s’est allégée par rapport au costume de bain du xixe siècle. Il s’agit d’un maillot en tissu épais qui couvre les épaules et le haut des cuisses. Une jupette cache les formes du fessier. Confort limité, mais entraves amoindries pour découvrir le plaisir de l’effort et de la vitesse. Les questions d’indécence liées au port de la tenue de bain ne la concernent pas encore. Gertrude Ederle se consacre corps et âme à la natation et suit les conseils de son entraîneuse. Elle s’exerce et s’exerce encore. Elle améliore sa technique du crawl, sa capacité respiratoire et la force propulsive associée. Elle remporte très vite ses premières compétitions et bat un record du monde dès l’âge de 14 ans en 1919 à Indianapolis : 800 mètres en nage libre, et en seulement 13,19 secondes.
La même année, une autre future médaillée des JO, Ethelda Bleibtrey, retire ses bas sur une plage de Palm Beach. Elle a 17 ans. Ce qui est d’abord considéré comme un acte de nudité répréhensible ouvre finalement la voie à l’abandon des bas dans les activités aquatiques. C’est l’époque du tiraillement des limites de la liberté féminine.
Pendant que les suffragettes défilent et réclament le droit de vote aux Etats-Unis, des patrouilles de policiers jalonnent les plages new-yorkaises, jaugent si les tenues de bain de ces dames sont conformes et embarquent au poste celles qu’ils jugent trop dénudées.
La jeunesse de Trudy ou l’esprit de la gagne
Un palmarès de 29 records pour l’adolescente
Célébrer le sport de haut niveau, c’est admirer le fait de se battre pour accomplir des performances et d’offrir le spectacle du geste parachevé, sans se restreindre à la notion de genre. A l’époque, cela contredit de plein fouet l’esprit d’humilité attendu de la femme dont on ne souhaite pas qu’elle se surpasse, et surtout pas qu’elle rivalise avec les hommes. Alignement propice des étoiles ? Gertrude Ederle dispose d’une mince possibilité d’échappée et elle s’en saisit. C’est le bon moment et le sport adéquat. Elle cherche toujours à améliorer sa technique et à gagner en vitesse. De 1920 à 1925, elle remporte de nombreux championnats et bat près de trente records mondiaux. En revanche, son audition ne s’améliore pas et le pronostic des médecins est sans appel : Gertrude risque de perdre définitivement la faculté d’entendre si elle continue de plonger la tête dans l’eau. Pas d’hésitation pour elle, car, nager, c’est l’essence de son être, sa raison de vivre.
La conquête de la flamme olympique
En 1924, la Women’s swimming association la sélectionne dans l’équipe américaine féminine qui participera aux Jeux olympiques à Paris. L’occasion pour elle de voyager, car, à l’époque, il faut l’accord de son mari ou de ses parents pour se déplacer seule. Mais, comme prévu par le règlement olympique très à cheval sur les bonnes mœurs, les jeunes femmes doivent être accompagnées d’un chaperon. Gertrude gagne la médaille d’or en équipe pour le relais 4 x 100 m et deux médailles de bronze pour le 100 mètres et le 400 mètres nage libre.
La nage en eau libre avant tout
Mais ce qu’elle préfère, c’est nager en pleine mer, sans lignes d’eau ni bassins limpides et standardisés. Faire corps avec l’onde, appréhender les vagues, comprendre les courants, fusionner avec l’océan immense. La mer berce et met à l’épreuve. Gertrude Ederle fend les flots. Elle est son propre maître : c’est une navigatrice. Elle se sent prête pour attaquer l’Everest de la natation : la traversée de la Manche. Pour s’y préparer, le 15 juin 1925, elle parcourt près de trente-quatre kilomètres entre Battery Park et Sandy Hook dans le New Jersey, en sept heures et onze minutes. Elle est la première femme à le faire et elle bat le record masculin.
Une pionnière de la traversée de la Manche
Un premier échec formateur
La même année, la Women’s swimming association accepte de soutenir Gertrude Ederle pour tenter la Manche. Le monde entier estime que c’est impossible pour une femme. Même la championne Annette Kellermann a déjà essayé sans succès. C’est sans compter que, engoncée dans une combinaison encombrante et sans aucune aérodynamique, elle n’avait aucune chance de réussir. Les hommes quant à eux ont l’habitude de tenter l’aventure nus et sans contraintes.
Jabez Wolffe, qui a entrepris lui-même vingt-et-une fois de franchir la Manche mais n’est jamais arrivé au bout, entraine la jeune femme. Après huit heures et quarante-cinq minutes de trajet, fatiguée, sujette à des crampes, Gertrude paraît faire un malaise. Jabez Wolffe exige qu’on la sorte de l’eau. Cette intervention et le rôle de l’entraîneur dans ce premier échec sont controversés. Ce qui est sûr, c’est que la nageuse va lui en tenir rigueur et se passer par la suite de ses services.
Un changement d’équipe
Cependant, cette capitulation donne raison à l’opinion publique. Elle sème surtout le doute dans les esprits de ceux qui gèrent l’association de natation féminine sur l’aptitude de Gertrude Ederle à relever ce défi. L’athlète souhaite retenter la traversée, mais le club ne l’épaule plus. Rien ne l’arrête : elle décroche un contrat avec le Chicago Tribune qui finance la course. Le prix à payer est plus que monnayable : elle sait qu’elle entre désormais dans la catégorie professionnelle et qu’elle doit faire une croix sur sa carrière olympique. Elle mise tout sur la Manche.
Elle demande alors à Thomas William Burgess de la préparer. Celui-ci compte à son actif dix-neuf essais de franchissement de la Manche, dont une réussite en 1911. Il s’est installé avec sa famille au Cap-Gris-Nez et son objectif est désormais d’entraîner les jeunes nageurs à battre les records sur cette épreuve.
Une préparation technique innovante
Le coach lui fait suivre une formation physique et psychologique rigoureuse. Elle bénéficie aussi de ses connaissances sur les courants marins et les obstacles à affronter ou éviter. Elle nagera le crawl. C’est une première, car la brasse est considérée comme la nage d’endurance par excellence. Mais elle maîtrise la régularité du rythme en huit temps avec une synchronisation des mouvements alternés et d’une expiration sous l’eau. L’atout du crawl réside dans le contrôle essentiel de la respiration, le maintien d’une force propulsive constante et d’une posture horizontale, le regard rivé au fond, avec des phases aquaplanées.
La mer est à 16° C. Sa sœur, puis Bill Burgess, l’enduisent de différentes couches d’huile et de graisses afin qu’elle résiste au froid et aux brûlures des méduses. Elle adopte également une tenue de bain deux pièces pour réduire les frottements de l’eau, sans trop faire de vagues sur le plan de la pudeur. Comme Burgess en 1911, elle se protège les yeux avec des lunettes de motard bien ajustées. Le soutien moral est important pour réussir : sa famille et d’autres nageurs embarquent dans un navire qui la suit de près. Un orchestre à son bord galvanise le moral des troupes. Le 6 août au matin, elle se lance dans l’aventure par une mer propice. Sa sœur Margaret Ederle ainsi que Lilian Cannon et Ishaq Helmi se relaient dans l’eau pour nager à ses côtés. Elle se nourrit de bouillon de volaille, de chocolat chaud et d’ananas. Un autre bateau d’arbitres, journalistes et cinéastes navigue à proximité.
« Le crawl pour la femme est une faute grave. Le corps de la femme n’est pas construit pour les mouvements violents du crawl. »
Henri Decoin, vers 1920.
Une victoire hors normes
Mais la tempête se lève en fin de journée. Les vagues ne l’effraie pas et elle continue d’avancer rapidement. La 12e heure est critique cependant, car Trudy fait marche arrière, mais pas pour renoncer. Le vent souffle à l’inverse du sens du courant marin et annule son effet. Elle persévère et réussit à trouver le bon passage pour se faufiler, parcourant six kilomètres supplémentaires. Elle atteint ainsi la plage anglaise de Kingsdown à 21h33, le 6 août 1926. Une foule d’admirateurs anglais l’attend. Elle a franchi la Manche en quatorze heures et trente-deux minutes. Non seulement elle est la première femme à remporter l’exploit, mais elle bat le record de temps détenu par l’Argentin Sebastian Tiraboschi depuis 1923. Par sa prouesse, elle impose également le crawl comme nage des longues distances.
« Les gens affirmaient que les femmes ne pouvaient pas traverser la Manche, mais j’ai prouvé le contraire. »
Gertrude Ederle, 1926
Le retour triomphal de la reine des vagues
A son arrivée à New-York, elle est accueillie avec une Ticker-Tape parade en bonne et due forme : 2 millions de personnes l’acclament et lâchent des confettis. Elle devient dans le cœur des Américains « Trudy, la Reine des vagues ».
« Je crois qu’aucun mot ne peut exprimer combien ce merveilleux accueil me touche. Je suis très fière de rapporter de tels honneurs à mon pays et à ma ville. Je savais que je le ferais ; j’y avais préparé mon esprit. »
Outre-Atlantique, les détracteurs vont bon train pour remettre en cause sa réussite. Mais, le même été, deux hommes font de meilleurs temps et une nageuse danoise du nom de Mille Carde Corson réussit aussi la traversée en une heure de plus qu’elle. Les soupçons s’amenuisent alors, lui rendant toute sa superbe.
Une femme forte
L’heure de savourer la victoire
Bulle auditive, passion de la nage. La reine des vagues maîtrise les flux marins mais se laisse emporter par les flots de la célébrité auxquels elle n’est pas préparée. Une chanson puis un film, dans lequel elle tourne en 1927, valorisent son exploit. Beaucoup de bruit dont elle ne profite pas et dans lequel elle s’éparpille. La tentation d’assujettir la femme à l’époque est toujours la plus forte. Baby doll ou pin-up. Mal conseillée, elle accepte de s’exhiber dans des shows où elle évolue dans un aquarium.
Une pionnière sans prétention de l’émancipation féminine
Le temps est passé d’essayer de battre des records. Peu importe. Ce qui compte c’est qu’elle ait fait corps avec les courants marins, qu’elle soit allée au bout de son rêve quand elle avait la force explosive de ses vingt ans. Ce qui compte, c’est qu’elle se soit accomplie par cette victoire. Elle est un exemple, la preuve que les femmes peuvent réussir en compétition sportive, elles aussi. Les jours et les mois qui suivent le 6 août 1926, les inscriptions féminines à la natation se multiplient. Gertrude Ederle a convaincu sur l’importance de pratiquer un sport, d’entretenir sa forme, de sortir de sa zone de confort, quel que soit son sexe. Des vocations de nageuses naissent ici et là. Et son rôle de mentor est gratifiant et lui suffit. Bien plus tard, avec le recul et le sourire, évacuant d’un revers de main les regrets, elle reconnaîtra qu’elle est la créatrice du maillot de bain deux-pièces. Tant pis si elle ne l’a pas fait breveter.
L’art de la résilience
Coup du sort en 1933 : elle subit une chute et se blesse à la colonne vertébrale. Cela sonne la fin claire et nette de sa carrière de sportive de haut niveau. Mais elle se bat encore et toujours, contre les risques de paralysie, contre le handicap, contre la mauvaise fortune. La rééducation est longue et elle gagne à nouveau. Sa soif de vivre et de nager l’emporte toujours, même lorsque sa surdité devient totale à ses quarante ans. Elle se voue à transmettre sa passion émancipatrice, à enseigner la natation à des enfants atteints de surdité partielle ou totale. C’est un phare incandescent, une longue vie de quatre-vingt-dix-huit années, une flamme intense qui ne s’éteint toujours pas depuis son décès en 2003.
De cette vibrante femme, qui a marqué l’histoire du sport et de l’émancipation féminine, le souvenir s’est ravivé quelque temps après sa disparition. Comment oublier sa détermination et sa passion faisant fi des stéréotypes encore bien ancrés au début du siècle dernier ? Les femmes d’aujourd’hui lui doivent de s’être érigée en exemple fondateur de bravoure féminine dans l’histoire de la compétition sportive et des sports de l’extrême.
L’aventure n’est pas finie, découvrez l’histoire de Beth French, une autre femme forte et résiliente qui a traversé la Manche à la nage.
Stéphanie Hémery pour Celles Qui Osent
En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent