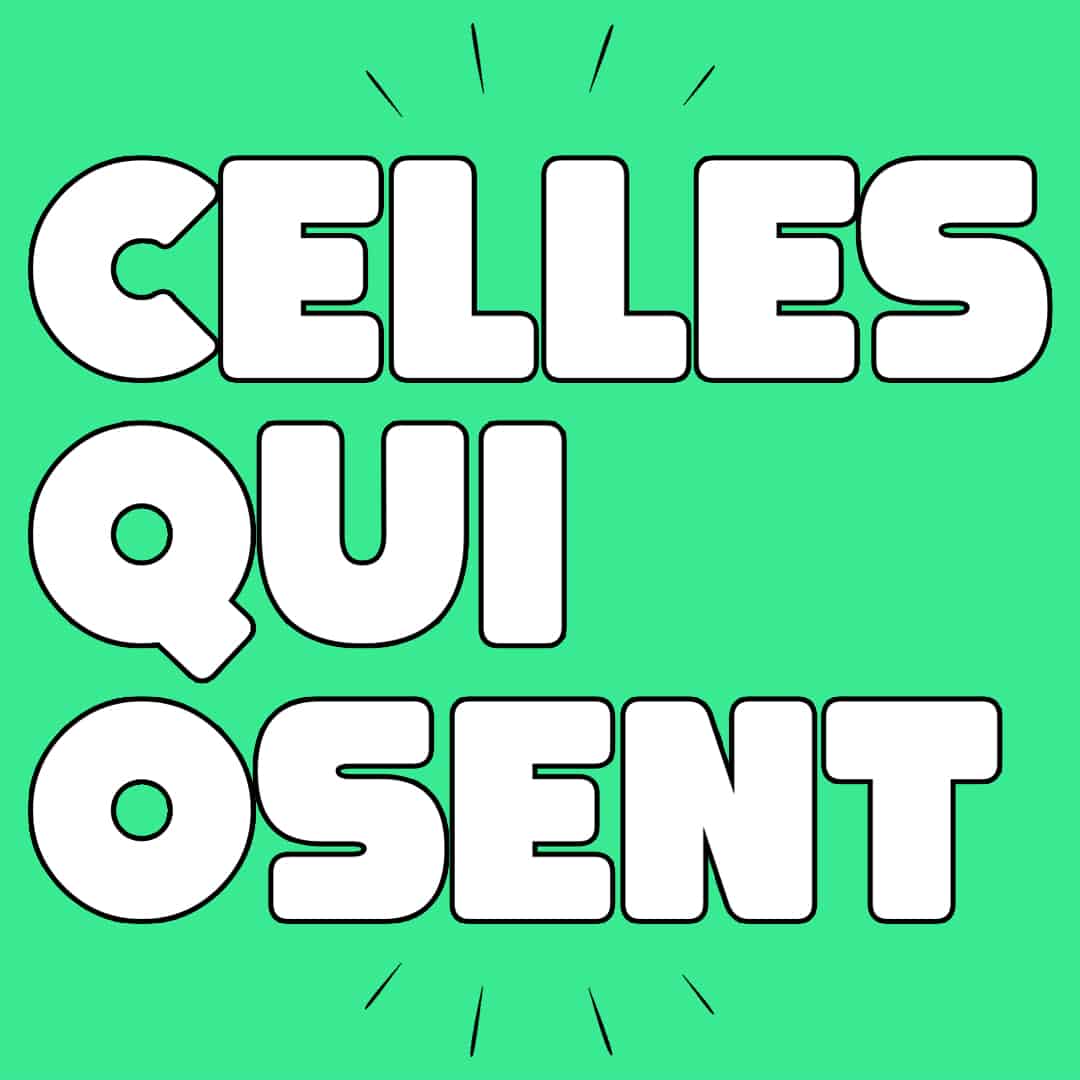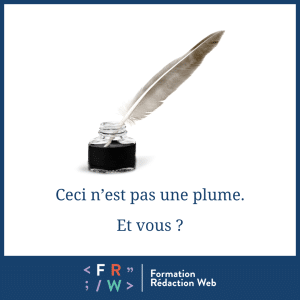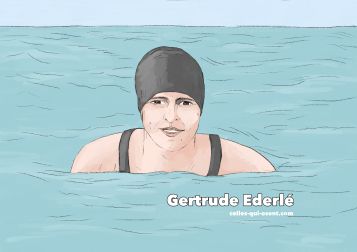Nous avons été invitées au cinéma l’Entrepôt, à Paris, pour l’avant-première du film La peur au ventre de Léa Clermont-Dion.
Avant même que le film ne commence, Léa Clermont-Dion, autrice et réalisatrice prend la parole. Elle parle d’un point de bascule. Un de ces moments où l’on sent que quelque chose est en train de glisser, d’un cran, d’un continent à l’autre. Le film qui va suivre en est le témoin.
La Peur au ventre : une bataille pour le droit des femmes à disposer de leurs corps
La première scène s’ouvre sur une rencontre avec Louise Desmarais, écrivaine canadienne, autrice de La bataille de l’avortement. Le ton est posé, l’écoute sincère, le regard sans commentaire. Et pourtant, l’alerte est déjà là.
Sans perdre de temps, Léa nous emmène assister à des manifestations anti-avortement. Elle part aussi à la rencontre de personnalités des deux bords : militant•e•s pro-choix et figures conservatrices se revendiquant « pro-vie »… Ce terme m’a d’ailleurs interrogée ; si l’on sanctuarise la vie fœtale au nom de principes absolus, pourquoi ces principes cesseraient-ils de s’appliquer dès lors qu’il s’agit de femmes en danger, de personnes pauvres, de migrants, de minorités discriminées, ou d’animaux d’élevage ? Dans la plupart des cas, ce n’est pas vraiment la vie qui est défendue, mais une vision idéologique de la vie humaine, hiérarchisée, patriarcale, souvent racialisée, parfois nationaliste. L’embryon devient le symbole d’une innocence supposée, qu’il faut protéger, pendant que d’autres vies — bien réelles, bien conscientes, bien souffrantes — sont tenues pour négligeables.
Rappelons donc que le choix de ce terme est en soi une stratégie : il déplace la question du droit à disposer de son corps vers un terrain moral, émotionnel, censément « universel », fondé sur la « vie ». Un mot refuge, doux en apparence, mais instrumentalisé.
Ce que le film montre, c’est que ces personnes « pro-vie » ne sont pas animées par leur seule croyance personnelle. Elles avancent en groupe, avec méthode, savent jouer sur les affects, se positionnent sur l’amour, la bienveillance et une pseudo-neutralité morale qui couvre un matraquage culpabilisant. Dans le même élan, elles qualifient les personnes pro-choix de « démons », de « tueurs d’enfants », de « dangereux extrémistes ». Leur posture publique, toujours ouverte, faussement naïve, faussement centrée sur l’amour, leur permet de gagner du terrain dans l’opinion…
Pendant ce temps, ce sont les droits fondamentaux des femmes qui reculent.
Car derrière ces sourires et cette rhétorique se cache une dure réalité : les mouvements anti-avortement sont, pour la plupart, directement liés à des réseaux conservateurs puissants, généreusement financés, ancrés dans des milieux proches — voire issus — de l’extrême droite. Ils ne se battent pas uniquement contre l’avortement. Ils portent avec eux une idéologie plus vaste : le rejet de l’égalité, la remise en cause des droits des minorités, l’attaque contre les personnes LGBT+, contre les personnes racisées, contre les modèles de société inclusifs.
C’est une offensive globale, méthodique, enracinée.
Un film féministe engagé de Léa Clermont-Dion
Parmi les figures interrogées, Monica Simpson, militante pro-choix, claire et déterminée explique son point de vue. En miroir, Abby Johnson, ancienne directrice de clinique américaine devenue militante anti-avortement diffuse sa propagande conservatrice jusqu’à Ottawa. Deux visions du monde, deux manières de regarder les corps, les droits, les vies.
Dans ce contexte, la posture de la réalisatrice est d’autant plus remarquable. Elle ne surjoue rien, n’élève jamais la voix. Elle donne la parole, écoute, rend visible. Et c’est précisément cette retenue qui rend son film si puissant. Il nous laisse face à notre propre responsabilité.
Depuis l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade, 20 états américains ont restreint l’accès à l’avortement, parfois de manière quasi-totale. En Pologne, l’interruption volontaire de grossesse n’est plus autorisée qu’en cas de viol ou d’inceste. À Malte, l’avortement est tout simplement interdit. Ce n’est pas une vague lointaine. C’est déjà là, en Europe.
Et pourtant, dans les manifestations pro-choix filmées par la réalisatrice, un constat revient comme une gifle silencieuse : l’absence des hommes. Pas de pancartes « leur corps, leur choix », pas de cris partagés. En face, dans les cortèges anti-avortement, les voix masculines, elles, sont là. Présentes. Audibles. Autoritaires, parfois.
Ce silence masculin ne signifie pas qu’aucun homme ne soutient les droits des femmes, des médecins courageux et engagés sont d’ailleurs présentés dans le film. Mais il interroge ; comment impliquer les hommes dans ce combat ? Comment les inviter à prendre la parole, à prendre position, à défendre l’autonomie des autres quand leur propre corps n’est pas menacé ?
Il faut sans doute de l’intelligence, de la clarté et de l’inclusion, comme dans ce film. Montrer, nommer, écouter, mais ne pas céder.
La peur au ventre sortira le 30 avril 2025 dans les salles et nous vous recommandons vivement de vous rendre au festival de cinéma de Florac Vues du Québec, du 8 au 13 avril 2025 !
Lucie Rondelet – Celles qui Osent
À voir aussi (de la même réalisatrice) :
En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent